




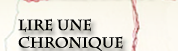

|
|
|
|
|||||
 |
 |
|
|
|
 |
||
 |
 |
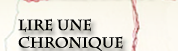 |
|||||
 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
« Décadence du roman », Les Nouvelles Littéraires, no 1159, 17-11-1949.
«Je lis beaucoup de romans en cette saison d’automne, pour mon malheur et ma délectation mélangés, et des romans de jeunes gens, qui expriment mieux, même et surtout dans leur maladresse, l’atmosphère de l’époque et l’évolution du genre que ceux des vieux routiers chevronnés, trop habiles, qui ménagent leurs forces, quand il leur en reste.
Et voici la première question que je me pose : y a-t-il une crise du roman ? L’abondance de la production, son bouillonnement semblent, au premier abord, témoigner contre une hypothèse défaitiste. En apparence seulement. Jamais le foisonnement n’a été de bon augure ; les cellules malades prolifèrent avec extravagance et frénésie. Aucun temps ne se montre plus fécond en tragédies que la fin du XVIIIe siècle, où la tragédie trépasse dans un morne paroxysme de pullulation. En serait-il de même aujourd’hui pour le roman ? Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Proust, et les psychologues raffinés, et les enfanteurs grossiers et opulents, Eugène Sue, Alexandre Dumas père, Paul Féval, auraient-ils épuisé sa sève, sa diversité ? Aboutirait-il aujourd’hui à une impasse ?
Car les genres, comme les organismes, comme les civilisations, naissent, balbutient, atteignent leur apogée, périssent, tantôt de mort subite, tantôt après une longue agonie où ils se débattent profusément. Nous en avons cent exemples. Et l’un d’eux, éclatant, celui de l’Opéra, qui succombe, après l’explosion wagnérienne, les derniers feux de Louise et de Pelléas et Mélisande, dans l’indifférence et la stérilité, tandis que le ballet, transformé par le goût actuel, dramatisé et élargi, ressuscite. Le roman, lui, présente des signes contradictoires que j’enregistre sans essayer de les concilier, de les interpréter heureusement ou sinistrement, quoique sa multiplication débordante ne contribue guère à me rassurer. Renouveau ou tumeur maligne ? Qui oserait formuler un diagnostic ? En tout cas, il se convulse, rue, se cherche fiévreusement, au moins chez les meilleurs serviteurs.
Deux courants bien distincts. D’une part le roman bien fait, selon la technique, les routines éprouvées pendant un siècle d’invention vive, de perfectionnement par l’usage et d’encroûtement à la fin, le roman bien fait, à la mode d’hier, nous déçoit, nous irrite, nous écoeure. Les gaucheries, d’autre part, les strapassements, les tâtonnements, les outrances des derniers venus nous inquiètent, nous passionnent, nous fatiguent, nous laissent sur notre soif. Très louablement ils se tendent, s’exténuent, ces garçons anxieux, à briser les vieux moules minéralisés, à se désentraver des lois de la narration chronologique, du portrait circonstancié, de l’exposition, du développement enchaîné. Mais, avouons-le, ils n’ont pas encore atteint leur but. Ils s’embrouillent, ils divaguent : cette vie brute, captée à la source, ce mouvement et ces éclairages spontanés, cette libération du temps logique et du descriptif, ils les poursuivent furieusement, ils en attrapent parfois, si je peux dire, le fumet, l’ombre, ils ne les ont pas fourrés dans leur gibecière, apprivoisés. Ils obtiennent de leurs lecteurs les plus bienveillants l’encouragement, la sympathie ; quant à l’intérêt soutenu, c’est une autre paire de manches ; ils allèchent et découragent vite. Nous voici donc entre l’eau fraîche et le picotin, entre le desséché et l’inachevé, lassés du rabattu, rétif au demi-informe. Situation fâcheuse.
Je considère naturellement l’affaire en gros ; je néglige le détail, le particulier ; je donne tout de go les impressions d’un homme un peu submergé, qui ne raffine guère, qui tape dans le tas. Et je ne parle que des Français ; j’ignore volontairement les Américains, qui bénéficient d’une culture plus récente, d’une sève qui n’a subi qu’une courte élaboration.
De toute évidence, une alternative se pose pour le roman : ou s’infuser un sang nouveau, ou disparaître du premier rang littéraire, qu’il occupe depuis plus d’un siècle, céder la vedette, comme jadis le poème épique et la tragédie, à je ne sais quoi d’autre dont l’outil, les moyens, plus primitifs, moins saturés de perfection conventionnelle, moins polis par les rabâchages, n’exposeraient pas autant l’artiste au besoin violent de rompre, fût-ce au prix des pire complications et de excès de la virtuosité. Aujourd’hui nous comptons, parmi les romanciers innombrables, ceux qui se satisfont de peu et vont leur trantran, et les autres, qui nous intéressent, qui s’engagent sur des voies difficiles, qui y titubent, s’y égarent et nous sèment. Poncifs ou essais, mais très peu d’œuvres durables, qui dépassent l’autobiographie inavouée, les Mémoires masqués à peine, très peu d’œuvres soumises à des lois neuves, encore dans la rigueur riche et la ductilité de leur jeunesse, capables de corseter leur inspiration et de les défendre contre le temps.
Peut-être faut-il attribuer cette décadence, au moins menaçante, à des causes qui tiennent plus aux circonstances et à l’accident qu’à l’essence même du genre. D’abord nous vivons à une époque si terriblement romanesque que le réel dépasse et déborde l’imagination, qu’il galope plus vite qu’elle. Nul de nos récents auteurs qui n’ait vécu des aventures atroces, qui n’ait participé à des drames, des épopées ou des bouffonneries terribles. C’est trop.
Le mûrissement et l’intensité des œuvres exigent des périodes relativement calmes. Le journal quotidien fait une concurrence déloyale à la fable. Les écrivains qui ont trop vu, et tumultueusement, se soulagent en vrac. Et trop d’hommes, parce qu’ils ont agi, souffert, étrangement bourlingué, et qui, jadis, eussent raconté leurs tribulations à leurs neveux ou consacré leurs loisirs à des Mémoires destinés à leur famille, se croient, parce que l’écriture, épidémie répandue, n’a pas de vaccin, obligés de publier un livre. Le roman, où tout se déverse depuis cinquante ans, leur offre, si un certain génie ne les prévient pas des risques, les plus lâches facilités, et, si leur génie les en avise, des obstacles difficilement surmontables. Défaut d’art chez les uns, hystérie de l’art chez les autres. De Charybde en Scylla.
La superstition, en outre, du nombre de pages, de l’épaisseur, hante la plupart. Non pas que je professe le dogme, qui a régné en France, de l’ouvrage bref et travaillé à l’extrême, dégraissé jusqu’à la plus rare maigreur. Mais pourquoi, quand on a moins à dire que ce qu’il y a dans Colomba ou dans Carmen, noircir plus de papier que pour Guerre et Paix ou Les Illusions perdues ? Il faut ce qu’il faut mais pas plus. La dimension ne dépend pas de la longueur. Au contraire bien souvent. Considérez Rabelais et comme il nous a tous roulés. Prenez en main ses œuvres complètes : vous verrez qu’elles ne forment qu’un volume relativement mince. Il a publié, et pendant peu d’années en somme, des cahiers d’actualités, de contes et d’allusions satiriques, une série d’almanachs ; leur collection ne pèse pas autant que nous l’imaginons de confiance. Le curé de Meudon a réalisé ce tour inouï de s’attirer, avec ce bagage, une réputation de munificence inépuisable, de torrent charrieur d’or et de scories, de diamants et d’ordures, de métaphysique et de scatologie. Chaque phrase donne l’impression d’appartenir à un monument immense ; nous croyons à ce mirage créé par la pâte somptueuse, le rythme, le vocabulaire et la syntaxe incantatoire des parties.
Beaucoup d’ouvrages, en revanche, qui se guindent à l’énormité, ne comportent qu’une accumulation de petites pages, un brochage de plaquettes. La grandeur ne dépend pas de la quantité, ni l’énergie du poids. Nos contemporains devraient méditer cette maxime, principalement ceux qui, avec une ardeur sympathique et mal contrôlée, rêvent d’accumuler les tomes, de rivaliser avec L’Astrée, en y remplaçant la fadeur et les bergeries par une obscénité plaquée, obligatoire, qui ne possède pas plus de jaillissement. Quant à cette obsession de la sexualité, et de la plus basse, de la plus ignoble, il y aurait beaucoup à dire. Je pense qu’elle témoigne de la soif de pureté de la génération qui a trente ans et de son âpre violence à déchirer les mensonges littéraires, à replacer dans le physique ce qui n’aurait pas dû en sortir.
C’est pécher gravement et insulter aux sentiments les plus beaux que de les fourrer partout, de s’en servir comme d’alibis. En qualité de confesseur, si je puis me parer de ce titre, j’absous volontiers. Seulement, en tant que lecteur, cette obscénité continue, ces morceaux de bravoure de la copulation, de ses dérivés anormaux et de ses ersatz, ces récits de Théramène d’une tristesse virulente et d’une maléfique morosité, tout cela en tant que lecteur m’ennuie par sa répétition et, fréquemment, par sa gratuité. L’esprit de contradiction me porterait aisément à une pudibonderie puritaine, à un pharisaïsme qui répugnent à mon caractère. Bien entendu, et voilà une conquête d’importance, on a le droit aujourd’hui de tout écrire franchement. Balzac ne se sentirait plus gêné aux entournures, mais rien n’oblige à écrire tout et hors de propos. Qui osera user du privilège de l’ellipse et du raccourci dans ces matières devenues lieux communs et dont la monotonie, la rhétorique ont quelque chose de scolairement infernal.
À l’égal des blanches, nous l’expérimentons, les oies noires finissent par excéder, et les catéchismes, les manuels de l’impudeur n’offrent pas plus de variétés que les autres. L’œuvre romanesque se situe sur un plan fort différent, vise la plénitude de l’homme et non pas uniquement son bas-ventre, à qui nous ne refusons plus sa place légitime, mais qui s’obstine, pour notre mortification, à tout envahir et à nous manger le cœur et le cerveau.
Alexandre Arnoux,
de l’Académie Goncourt.