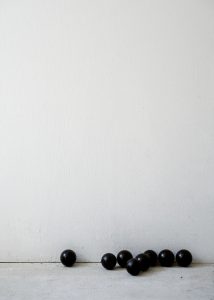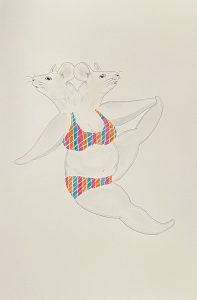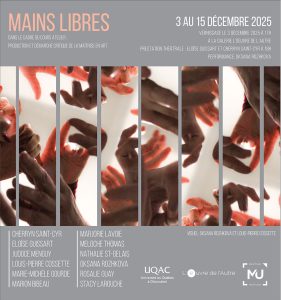Du 15 janvier au 26 février 2026
TRANSITS
Yann Pocreau
Un « transit », en astronomie, réfère au passage d’un corps céleste devant un autre, la disparition temporaire d’une étoile, d’une planète par un objet astronomique qui se déplace, qui franchit la lumière et les méandres de l’espace-temps. Si les sciences du ciel sont particulièrement informées de ces phénomènes, le fossé entre la mathématique de ces déplacements, la géométrie pure qui dessine le ciel et entre l’échelle bien relative de notre temps sur terre, n’en est que creusée. C’est là que tout devient, disons-le, vertigineux.
Nombres de mes projets, dans les dernières années, abordaient cette idée de « vertiges cosmiques » ou encore celle du « sentiment océanique ». Empreints d’un certain existentialisme, d’une certaine spiritualité même, ces concepts sont liés à l’expérience bouleversante qui nous habite lorsqu’on se sent face au plus grand que soi, lorsque nous croyons être dans un état de conscience et d’unité avec l’univers. Souvent brefs, complètement enivrants, ces moments sont particulièrement angoissants. Je n’arrive plus à me défaire de l’idée que penser le monde par l’art passe indubitablement par penser notre « passage » ici. Je m’intéresse donc à cette idée de translation et de déplacement qui doit passer par l’occultation du regard, par un moment d’obscurité. Je n’ai pas la prétention de savoir comment regarder ou même de guider le regard de qui que ce soit, mais je sais que chercher à voir est pour moi plus rassurant que simplement regarder. Je me plais donc à penser ces formes aussi simples que parlantes, ces liens entre ce désir de figer par la photographie, les minutes, les heures. J’ai réuni pour cette exposition des projets inédits, d’autres qui habitent l’atelier depuis quelque temps, des objets trouvés, des photographies altérées, des portraits dégradés qui interrogent avec – je l’espère – une poésie et une certaine sensibilité ce rapport à un interstice en mouvement, logé entre le temps et la lumière.
Yann Pocreau
*L’artiste tient à remercier Nathalie Villeneuve pour la merveilleuse invitation, toute l’équipe du Centre Sagamie pour leur amitié et leur soutien à la production, l’atelier CLARK pour leur savoir-faire et leur enthousiasme, la galerie Blouin Division pour leur extraordinaire travail, Julien, Emmanuelle et Ayden pour leur indispensable présence au quotidien.
Mes recherches sont portées par l’application de ma pensée photographique aux multiples définitions de la lumière que j’explore à travers plusieurs médiums, donc l’image, la sculpture et l’installation. Cette lumière, son apport narratif à la lecture qu’on fait des images et l’histoire de la photographie font ainsi de plus en plus partie de mon vocabulaire. Je m’intéresse à évaluer comment la lumière impacte sur la visibilité du monde que nous habitons, à ses façons de l’enregistrer. Ainsi, je m’intéresse grandement à la lumière, à sa matérialité, à ce qu’elle sait, informe ou aux affects qu’elle convoque. Entre un simple dialogue avec la science, avec un certain existentialisme, je pense et produis des expositions qui tentent d’aborder les liens macros et micros qui façonnent et dessinent notre environnement, mais aussi et surtout ici aux projections que nous nous en faisons.
Yann Pocreau est né à Québec en 1980. Dans ses recherches récentes, à travers différents types de médiums dont la photographie, la sculpture et l’installation, il s’intéresse à la lumière comme sujet vivant et à l’effet de celle-ci sur la trame narrative des images. Il a participé à plusieurs expositions canadiennes, américaines et européennes dont aux Rencontres photographiques d’Arles, au Musée des beaux-arts de Montréal et au Toronto Image Centre. Son travail a été commenté dans divers magazines et ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections, dont celles de la Ville de Montréal, du Musée d’art contemporain de Montréal, du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d’art de Joliette et de la Galerie de l’UQAM. Il est représenté par la galerie Blouin Division à Tiohtiá:ke / Mooniyang / Montréal où il vit et travaille. Il est le récipiendaire 2024 du Prix Louis-Comtois.