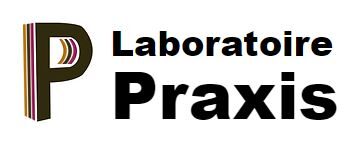Habituellement nommé décor par les non-initiés, ce que la communauté des développeurs de jeu vidéo désigne couramment comme « environnement » s’est considérablement transformé depuis l’émergence de l’objet vidéoludique. En près de 50 ans, nous sommes passés des environnements désertiques des jeux comme Pong (Atari, 1972) aux environnements riches en détails comme Shadow of the Tomb Raider (Eidos-Montréal, 2018). Toutefois, les pratiques de développement d’environnement de jeu vidéo en industrie demeurent encore mal-étudiées et mal comprises. De surcroît, la rationalisation de la production engendre des exigences considérables chez les praticiens développeurs (par ex. l’augmentation de la taille des équipes, la surspécialisation technique, les changements constants technologiques) (Tschang, 2007).
Malgré cette considérable complexification des produits et des processus, les environnements de jeu vidéo sont encore d’ordinaire relayés au second plan et peu considérés dans la littérature scientifique. Pourtant, des stratégies visuelles environnementales existent aujourd’hui pour orienter le joueur et suggérer les actions à accomplir. Comme le résument les travaux de Madigan (2013) et Kopacz (2004), l’emploi d’une couleur particulière, constante et en contraste avec le reste de l’environnement favorise la reconnaissance des éléments interactifs. Les exemples les plus représentatifs sont l’utilisation de la couleur rouge dans Mirror’s Edge (Electronic Arts, 2008, 2016) ou encore les traces blanches dans Rise of the Tomb Raider (Crystal Dynamics, 2015).
Pour enrichir les connaissances sur la place des environnements dans la littérature scientifique francophone, cet appel à texte propose donc d’élargir l’analyse des environnements en s’intéressant autant à leur développement en industrie qu’à leur réception par la communauté. En d’autres termes, cet appel à textes propose de renouveler l’étude des environnements complexes vidéoludiques selon les deux perspectives suivantes : (1) les perspectives théoriques et méthodologiques de la pratique de développement et (2) l’évolution de la réception.
En premier lieu, l’appel à textes invite les contributions adoptant des perspectives théoriques et méthodologiques visant à étudier et comprendre « la pratique » de développement d’environnement vidéoludique, en termes de conception et de création. Nous invitons les perspectives théoriques souhaitant dépasser un paradigme « rationaliste » dans les études des jeux. En effet, bien que ce paradigme ait produit des connaissances scientifiques éclairantes sur le développement et les développeurs, il aurait en même temps contribué à représenter les pratiques en industrie de manière trop idéalisée, objectivée, décontextualisée et désincarnée (Kuittinen & Holopainen, 2009 ; O’Donnell, 2014 ; Kultima, 2015; Whitson, 2018). Par exemple, dans la recherche en design de jeu, plusieurs chercheurs (par ex. Kuittinen & Holopainen, 2009 ; Kultima, 2015; Chiapello, 2015) reprochent à ce paradigme d’avoir représenté la pratique de design (conception) de jeu trop centrée sur les jeux et les joueurs. Intéressés à théoriser la pratique, ces mêmes chercheurs proposent de se référer à une perspective théorique pragmatiste provenant du design. En se référant au modèle du praticien réflexif designer (Schön, 1983), Kultima (2015) donne sens au processus situé de design de jeu, tandis que Chiapello (2015 ; 2019) donne sens à la créativité située des designers de jeu. De plus, les chercheurs en design de jeu mentionnés s’intéressent à étudier les praticiens en contexte réel, leur processus réflexifs, leurs savoirs et les situations rencontrées. Suite à ces idées, nous invitons les contributions adoptant des perspectives théoriques (en design ou dans d’autres champs disciplinaires pertinents) qui étudient les pratiques de conception et de création d’environnement vidéoludique.
L’appel à textes invite les contributions adoptant de plus des perspectives méthodologiques qualitatives et interprétatives, dont les objectifs sont d’explorer, de décrire et de comprendre la pratique réelle dans sa complexité, notamment la pratique située et incarnée par les développeurs dans les studios. Selon O’Donnell (2014) et Whitson (2018), il est nécessaire d’étudier la pratique en industrie en se référant à des approches ethnographiques qui sollicitent les praticiens et les studios directement (par ex. au moyen d’observations et d’entretiens in situ). Jusqu’à maintenant, cette perspective ethnographique permet de signaler des compétences techniques, mais aussi « non techniques » chez les développeurs (par ex. résolution de conflit, collaboration interdisciplinaire) (O’Donnell, 2014; Whitson, 2018). Des récentes recherches qualitatives explorent des pratiques spécifiques dans le développement de jeu vidéo, telles que la pratique des designers (Chiapello, 2019) et la pratique des artistes (Hawey, 2021). Cependant, la recherche ethnographique ne serait pas sans poser des défis considérables (par ex. éthique ; négociation et accès aux studios ; confidentialité et diffusion des résultats) (Whitson, 2012; O’Donnell, 2014).
En somme, la première perspective d’analyse de cet appel à textes invite les contributions adoptant une « épistémologie de la pratique » (Schön, 1983 ; 1987), avec pour intérêt d’étudier et de comprendre les pratiques de conception et de création d’environnement vidéoludique. Cette posture peut conduire à vouloir par exemple : expliciter les savoirs de la pratique ; solliciter directement les praticiens concepteurs et créateurs ; informer et guider la pratique en industrie, la formation et/ou la recherche académique. La même posture peut conduire à poser des questions, telles que :
– Comment les développeurs eux-mêmes donnent sens à leur pratique de conception et de création d’environnement vidéoludique?
– Quelles sont leurs préoccupations technologiques / esthétiques / éthiques / organisationnelles / politiques dans le cadre de leur travail?
– Quelles sont les situations problématiques rencontrées?
– Quels sont les savoirs et méthodes mobilisés ou développés?
L’appel à textes invite en second lieu les contributions étudiant la tendance à l’iconisation des indicateurs de jouabilité, ainsi que les pratiques actuelles sous des angles peu étudiés, comme ceux de l’affordance (Gibson, 1979; Gaver, 1991; Norman, 2013), de l’ingénierie sémiotique (De Souza, 2005) ou encore de la logique peircienne pour mieux comprendre comment ces signes subtilement intégrés aux environnements de jeu réussissent à guider le joueur efficacement.
Jusqu’à la fin des années 2000, il est relativement facile de distinguer à l’écran ce qui est de l’ordre de l’environnement de ce avec quoi le joueur peut interagir. Les environnements sont plutôt désertiques et passablement peuplés d’éléments qu’il est possible de détruire (caisses, vases, etc.) ou de ramasser (munitions, kit de santé, etc.). Jusque-là donc, la différence entre les éléments interactifs et l’environnement est évidente, si évidente que l’apport de l’environnement est plutôt majoritairement associé à l’essor des phénomènes d’immersion. Toutefois, avec la croissance des avancées technologiques, le contenu graphique vidéoludique se complexifie. À partir du début des années 2010, nous assistons en effet à une surenchère de la qualité visuelle. Les environnements proposent un rendu si dense et si détaillé qu’il est parfois laborieux de distinguer ce avec quoi le joueur peut interagir de ce qui est de l’ordre de la simple représentation environnementale. Pour assurer la visibilité de la représentation des systèmes de jeu, les concepteurs développent une pratique qui devient dominante et qui consiste à ajouter des signes dans l’environnement pour assister le joueur.
Deux tendances s’affrontent néanmoins sur ce sujet. La tendance qui se manifeste dans un premier temps est celle de l’ajout de signes en fort contraste avec le reste du contenu graphique. Les symboles traditionnellement utilisés dans les interfaces se retrouvent dans l’environnement de jeu sous la forme de flèches pour désigner la trajectoire à suivre ou encore de points d’exclamation au-dessus d’un personnage non-joueur pour indiquer la disponibilité d’une quête pour le joueur de World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004-2022). Pour de nombreux auteurs (Hodent, 2018; Preece, Rogers, et Sharp, 2002; Jørgensen, 2013), ces signes se doivent d’être en fort contraste avec l’environnement pour assurer leur visibilité et, par ricochet, une meilleure expérience du jeu par l’utilisateur. La seconde tendance, plus tardive, se manifeste vers la fin des années 2010. Un nombre grandissant de succès commerciaux font état de signes moins contrastés et plus subtils pour orienter le joueur. Comme Fagerbolt et Lorentzon (2009) le précisent, ces signes participent à la diégèse de l’objet vidéoludique tout en assumant des propriétés de jouabilité.
Selon la logique peircienne (Peirce, C.S., 1931-1958), la première tendance se résume à l’utilisation de deux univers de signes tandis que la seconde se contente d’un seul. Plus précisément, la première tendance utilise principalement des signes iconiques pour la représentation du monde et accessoirement des signes symboliques pour indiquer le système de jeu; le point d’exclamation précité au-dessus d’un personnage non-joueur dans World of Warcraft en est d’ailleurs un exemple très représentatif. La seconde tendance, quant à elle, utilise majoritairement des signes iconiques. Autant la représentation du monde que la représentation du système de jeu sont de l’ordre de l’iconique. Un des meilleurs exemples pour illustrer cette tendance est sans doute celui de Tomb Raider avec le blanchiment des bordures de falaises pour signifier le chemin à suivre au joueur.
Chiapello, L. (2015). Creativity in the video game industry: Using Schön’s constants to understand frame creation. The Value of Design Research. Paris: 11th European Academy of Design Conference (EAD).
Chiapello, L. (2019). Le pragmatisme comme épistémologie pour le design de jeux Enquête sur la créativité et le processus de design. (Thèse de doctorat). Université de Montréal, Montréal.
Cross, N. (2011). Design thinking. New York: Bloomsbury.
Fagerholt, E et Lorentzon, M. (2009), Beyond the HUD: User Interfaces for increased Player Immersion in FPS Games. Master’s thesis, Chalmers University of Technology.
Gaver, W. (1991). « Technology Affordances » dans Robertson, Scott P., Olson, Gary M., Olson, Judith S. (ed.): Proceedings of the ACM CHI 91 Human Factors in Computing Systems Conference.
Gibson, J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception, Boston: Houghton Mifflin.
Hawey, D. (2021). La pratique professionnelle des artistes-développeurs de jeu vidéo : Une exploration de leur processus réflexif de design. (Thèse de doctorat). Université de Montréal, Montréal.
Hodent, C. (2018). The gamer’s brain: how neuroscience and UX can impact video game design. Boca Raton, FL: CRC Press.
Jenkins, H. (2004), “Game design as narrative architecture”, in Wardrip-Fruin, p.118-130.
Jørgensen, K. (2013). Gameworld Interfaces, Cambridge: MIT Press.
Kopacz, J. (2004). Color In Three-Dimensional Design. New York, NY: McGraw-Hill.
Kuittinen, J., & Holopainen, J. (2009). Some Notes on the Nature of Game Design. Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice and Theory. Proceedings of DiGRA 2009.
Kultima, A. (2015). Game design research. Academic MindTrek 2015 (pp. 18-25). Tampere, Finland: ACM.
Lawson, B. (2005). How Designers Think: The Design Process Demystified (éd. 4). New York: Architectural Press.
Löwgren, J., & Stolterman, E. (2007). Thoughtful interaction design: A design perspective on information technology. Cambridge: MIT Press.
Madigan, J. (2013). Why Do Color Coded Clues In Level Design Work? Retrieved 08/27, 2014, from http://www.psychologyofgames.com/2013/09/why-do-color-coded-clues-in-level-designwork/#foot_text_1752_1
Nelson, H. G., & Stolterman, E. (2012). The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World (éd. 2). London, England: MIT Press.
Norman, D. (2013). The Psychology of Everyday Things, New York: Basic Books.
O’Donnell, C. (2014). Developer’s Dilemma: The Secret World of Videogame Creators. MIT Press.
Peirce, C.S. (1931-1958) The Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Harvard University Press, Cambridge, Vol. 1-8.
Preece, J., Rogers, Y. et Sharp H. (2002). Interaction design: beyond human-computer interaction. New York, NY: J. Wiley & Sons.
Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.
Schell, J. (2008). The art of game design: a book of lenses, Amsterdam, Boston: Elsevier/Morgan Kaufmann.
Tschang, F. T. Balancing the Tensions between Rationalization and Creativity in the Video Games Industry. Organization Science. Innovation at and across Multiple Levels of Analysis, 18, 6 (2007), 989-1005.
Whitson, J. R. (2012). Thèse de doctorat intitulée : Game Design by Numbers: Instrumental Play and the Quantitative Shift in the Digital Game Industry. Ottawa, Canada: Carleton University.
Whitson, J. R. (2018). What Can We Learn From Studio Studies Ethnographies? A “Messy” Account of Game Development Materiality, Learning, and Expertise. Games and Culture, 1-23.
Veuillez envoyer votre résumé en français (entre 300 et 500 mots, excluant les références) de votre proposition d’ici le 15 février 2023 en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse suivante : https://forms.office.com/r/a6VPuAyqa0. Le résumé de votre proposition doit comprendre minimalement le titre, le sujet et la problématique abordée. Le formulaire vous demandera d’inclure également une courte bio. Vous serez informés de l’acceptation ou du refus de votre proposition par courriel en mars 2023.
En vue du texte final, le nombre de mots devra se situer entre 5000 et 7000 mots (excluant les références). Des informations plus précises en lien avec le format seront communiquées pour les textes acceptés. Suite à l’acceptation de votre proposition, vous devrez faire parvenir votre texte final avant la date de tombée fixée au 30 mai 2023 aux adresses suivantes :
erwan.davisseau@uqat.ca
dhawey@nad.ca
Vous serez prévenus ultérieurement concernant la date exacte de publication du numéro Kinéphanos.
Kinephanos est une revue Web avec arbitrage. Chaque texte reçu est soumis en anonymat à une double évaluation par les pairs. Kinephanos n’exige pas l’exclusivité de vos textes. Toutefois, l’article soumis doit être publié pour la première fois. Les textes qui paraîtront dans d’autres périodiques par la suite devront citer Kinephanos comme première source.
Pour connaître toutes les normes de présentation des manuscrits, consultez la politique éditoriale de Kinephanos.
Kinephanos est une revue Web universitaire, qui se veut bilingue, interdisciplinaire et transdisciplinaire, dont l’objectif est d’étudier les questions qui touchent de près ou de loin le cinéma et les médias populaires. Les films et téléséries populaires, les jeux vidéo, les technologies émergentes ainsi que la culture des fans constituent les principaux intérêts de la revue. Les approches favorisées sont les études cinématographiques, les théories de la communication, les sciences des religions, la philosophie et les études culturelles et médiatiques.
www.kinephanos.ca
Habituellement nommé décor par les non-initiés, ce que la communauté des développeurs de jeu vidéo désigne couramment comme « environnement » s’est considérablement transformé depuis l’émergence de l’objet vidéoludique. En près de 50 ans, nous sommes passés des environnements désertiques des jeux comme Pong (Atari, 1972) aux environnements riches en détails comme Shadow of the Tomb Raider (Eidos-Montréal, 2018). Toutefois, les pratiques de développement d’environnement de jeu vidéo en industrie demeurent encore mal-étudiées et mal comprises. De surcroît, la rationalisation de la production engendre des exigences considérables chez les praticiens développeurs (par ex. l’augmentation de la taille des équipes, la surspécialisation technique, les changements constants technologiques) (Tschang, 2007).
Malgré cette considérable complexification des produits et des processus, les environnements de jeu vidéo sont encore d’ordinaire relayés au second plan et peu considérés dans la littérature scientifique. Pourtant, des stratégies visuelles environnementales existent aujourd’hui pour orienter le joueur et suggérer les actions à accomplir. Comme le résument les travaux de Madigan (2013) et Kopacz (2004), l’emploi d’une couleur particulière, constante et en contraste avec le reste de l’environnement favorise la reconnaissance des éléments interactifs. Les exemples les plus représentatifs sont l’utilisation de la couleur rouge dans Mirror’s Edge (Electronic Arts, 2008, 2016) ou encore les traces blanches dans Rise of the Tomb Raider (Crystal Dynamics, 2015).
Pour enrichir les connaissances sur la place des environnements dans la littérature scientifique francophone, cet appel à texte propose donc d’élargir l’analyse des environnements en s’intéressant autant à leur développement en industrie qu’à leur réception par la communauté. En d’autres termes, cet appel à textes propose de renouveler l’étude des environnements complexes vidéoludiques selon les deux perspectives suivantes : (1) les perspectives théoriques et méthodologiques de la pratique de développement et (2) l’évolution de la réception.
En premier lieu, l’appel à textes invite les contributions adoptant des perspectives théoriques et méthodologiques visant à étudier et comprendre « la pratique » de développement d’environnement vidéoludique, en termes de conception et de création. Nous invitons les perspectives théoriques souhaitant dépasser un paradigme « rationaliste » dans les études des jeux. En effet, bien que ce paradigme ait produit des connaissances scientifiques éclairantes sur le développement et les développeurs, il aurait en même temps contribué à représenter les pratiques en industrie de manière trop idéalisée, objectivée, décontextualisée et désincarnée (Kuittinen & Holopainen, 2009 ; O’Donnell, 2014 ; Kultima, 2015; Whitson, 2018). Par exemple, dans la recherche en design de jeu, plusieurs chercheurs (par ex. Kuittinen & Holopainen, 2009 ; Kultima, 2015; Chiapello, 2015) reprochent à ce paradigme d’avoir représenté la pratique de design (conception) de jeu trop centrée sur les jeux et les joueurs. Intéressés à théoriser la pratique, ces mêmes chercheurs proposent de se référer à une perspective théorique pragmatiste provenant du design. En se référant au modèle du praticien réflexif designer (Schön, 1983), Kultima (2015) donne sens au processus situé de design de jeu, tandis que Chiapello (2015 ; 2019) donne sens à la créativité située des designers de jeu. De plus, les chercheurs en design de jeu mentionnés s’intéressent à étudier les praticiens en contexte réel, leur processus réflexifs, leurs savoirs et les situations rencontrées. Suite à ces idées, nous invitons les contributions adoptant des perspectives théoriques (en design ou dans d’autres champs disciplinaires pertinents) qui étudient les pratiques de conception et de création d’environnement vidéoludique.
L’appel à textes invite les contributions adoptant de plus des perspectives méthodologiques qualitatives et interprétatives, dont les objectifs sont d’explorer, de décrire et de comprendre la pratique réelle dans sa complexité, notamment la pratique située et incarnée par les développeurs dans les studios. Selon O’Donnell (2014) et Whitson (2018), il est nécessaire d’étudier la pratique en industrie en se référant à des approches ethnographiques qui sollicitent les praticiens et les studios directement (par ex. au moyen d’observations et d’entretiens in situ). Jusqu’à maintenant, cette perspective ethnographique permet de signaler des compétences techniques, mais aussi « non techniques » chez les développeurs (par ex. résolution de conflit, collaboration interdisciplinaire) (O’Donnell, 2014; Whitson, 2018). Des récentes recherches qualitatives explorent des pratiques spécifiques dans le développement de jeu vidéo, telles que la pratique des designers (Chiapello, 2019) et la pratique des artistes (Hawey, 2021). Cependant, la recherche ethnographique ne serait pas sans poser des défis considérables (par ex. éthique ; négociation et accès aux studios ; confidentialité et diffusion des résultats) (Whitson, 2012; O’Donnell, 2014).
En somme, la première perspective d’analyse de cet appel à textes invite les contributions adoptant une « épistémologie de la pratique » (Schön, 1983 ; 1987), avec pour intérêt d’étudier et de comprendre les pratiques de conception et de création d’environnement vidéoludique. Cette posture peut conduire à vouloir par exemple : expliciter les savoirs de la pratique ; solliciter directement les praticiens concepteurs et créateurs ; informer et guider la pratique en industrie, la formation et/ou la recherche académique. La même posture peut conduire à poser des questions, telles que :
– Comment les développeurs eux-mêmes donnent sens à leur pratique de conception et de création d’environnement vidéoludique?
– Quelles sont leurs préoccupations technologiques / esthétiques / éthiques / organisationnelles / politiques dans le cadre de leur travail?
– Quelles sont les situations problématiques rencontrées?
– Quels sont les savoirs et méthodes mobilisés ou développés?
L’appel à textes invite en second lieu les contributions étudiant la tendance à l’iconisation des indicateurs de jouabilité, ainsi que les pratiques actuelles sous des angles peu étudiés, comme ceux de l’affordance (Gibson, 1979; Gaver, 1991; Norman, 2013), de l’ingénierie sémiotique (De Souza, 2005) ou encore de la logique peircienne pour mieux comprendre comment ces signes subtilement intégrés aux environnements de jeu réussissent à guider le joueur efficacement.
Jusqu’à la fin des années 2000, il est relativement facile de distinguer à l’écran ce qui est de l’ordre de l’environnement de ce avec quoi le joueur peut interagir. Les environnements sont plutôt désertiques et passablement peuplés d’éléments qu’il est possible de détruire (caisses, vases, etc.) ou de ramasser (munitions, kit de santé, etc.). Jusque-là donc, la différence entre les éléments interactifs et l’environnement est évidente, si évidente que l’apport de l’environnement est plutôt majoritairement associé à l’essor des phénomènes d’immersion. Toutefois, avec la croissance des avancées technologiques, le contenu graphique vidéoludique se complexifie. À partir du début des années 2010, nous assistons en effet à une surenchère de la qualité visuelle. Les environnements proposent un rendu si dense et si détaillé qu’il est parfois laborieux de distinguer ce avec quoi le joueur peut interagir de ce qui est de l’ordre de la simple représentation environnementale. Pour assurer la visibilité de la représentation des systèmes de jeu, les concepteurs développent une pratique qui devient dominante et qui consiste à ajouter des signes dans l’environnement pour assister le joueur.
Deux tendances s’affrontent néanmoins sur ce sujet. La tendance qui se manifeste dans un premier temps est celle de l’ajout de signes en fort contraste avec le reste du contenu graphique. Les symboles traditionnellement utilisés dans les interfaces se retrouvent dans l’environnement de jeu sous la forme de flèches pour désigner la trajectoire à suivre ou encore de points d’exclamation au-dessus d’un personnage non-joueur pour indiquer la disponibilité d’une quête pour le joueur de World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004-2022). Pour de nombreux auteurs (Hodent, 2018; Preece, Rogers, et Sharp, 2002; Jørgensen, 2013), ces signes se doivent d’être en fort contraste avec l’environnement pour assurer leur visibilité et, par ricochet, une meilleure expérience du jeu par l’utilisateur. La seconde tendance, plus tardive, se manifeste vers la fin des années 2010. Un nombre grandissant de succès commerciaux font état de signes moins contrastés et plus subtils pour orienter le joueur. Comme Fagerbolt et Lorentzon (2009) le précisent, ces signes participent à la diégèse de l’objet vidéoludique tout en assumant des propriétés de jouabilité.
Selon la logique peircienne (Peirce, C.S., 1931-1958), la première tendance se résume à l’utilisation de deux univers de signes tandis que la seconde se contente d’un seul. Plus précisément, la première tendance utilise principalement des signes iconiques pour la représentation du monde et accessoirement des signes symboliques pour indiquer le système de jeu; le point d’exclamation précité au-dessus d’un personnage non-joueur dans World of Warcraft en est d’ailleurs un exemple très représentatif. La seconde tendance, quant à elle, utilise majoritairement des signes iconiques. Autant la représentation du monde que la représentation du système de jeu sont de l’ordre de l’iconique. Un des meilleurs exemples pour illustrer cette tendance est sans doute celui de Tomb Raider avec le blanchiment des bordures de falaises pour signifier le chemin à suivre au joueur.
Chiapello, L. (2015). Creativity in the video game industry: Using Schön’s constants to understand frame creation. The Value of Design Research. Paris: 11th European Academy of Design Conference (EAD).
Chiapello, L. (2019). Le pragmatisme comme épistémologie pour le design de jeux Enquête sur la créativité et le processus de design. (Thèse de doctorat). Université de Montréal, Montréal.
Cross, N. (2011). Design thinking. New York: Bloomsbury.
Fagerholt, E et Lorentzon, M. (2009), Beyond the HUD: User Interfaces for increased Player Immersion in FPS Games. Master’s thesis, Chalmers University of Technology.
Gaver, W. (1991). « Technology Affordances » dans Robertson, Scott P., Olson, Gary M., Olson, Judith S. (ed.): Proceedings of the ACM CHI 91 Human Factors in Computing Systems Conference.
Gibson, J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception, Boston: Houghton Mifflin.
Hawey, D. (2021). La pratique professionnelle des artistes-développeurs de jeu vidéo : Une exploration de leur processus réflexif de design. (Thèse de doctorat). Université de Montréal, Montréal.
Hodent, C. (2018). The gamer’s brain: how neuroscience and UX can impact video game design. Boca Raton, FL: CRC Press.
Jenkins, H. (2004), “Game design as narrative architecture”, in Wardrip-Fruin, p.118-130.
Jørgensen, K. (2013). Gameworld Interfaces, Cambridge: MIT Press.
Kopacz, J. (2004). Color In Three-Dimensional Design. New York, NY: McGraw-Hill.
Kuittinen, J., & Holopainen, J. (2009). Some Notes on the Nature of Game Design. Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice and Theory. Proceedings of DiGRA 2009.
Kultima, A. (2015). Game design research. Academic MindTrek 2015 (pp. 18-25). Tampere, Finland: ACM.
Lawson, B. (2005). How Designers Think: The Design Process Demystified (éd. 4). New York: Architectural Press.
Löwgren, J., & Stolterman, E. (2007). Thoughtful interaction design: A design perspective on information technology. Cambridge: MIT Press.
Madigan, J. (2013). Why Do Color Coded Clues In Level Design Work? Retrieved 08/27, 2014, from http://www.psychologyofgames.com/2013/09/why-do-color-coded-clues-in-level-designwork/#foot_text_1752_1
Nelson, H. G., & Stolterman, E. (2012). The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World (éd. 2). London, England: MIT Press.
Norman, D. (2013). The Psychology of Everyday Things, New York: Basic Books.
O’Donnell, C. (2014). Developer’s Dilemma: The Secret World of Videogame Creators. MIT Press.
Peirce, C.S. (1931-1958) The Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Harvard University Press, Cambridge, Vol. 1-8.
Preece, J., Rogers, Y. et Sharp H. (2002). Interaction design: beyond human-computer interaction. New York, NY: J. Wiley & Sons.
Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.
Schell, J. (2008). The art of game design: a book of lenses, Amsterdam, Boston: Elsevier/Morgan Kaufmann.
Tschang, F. T. Balancing the Tensions between Rationalization and Creativity in the Video Games Industry. Organization Science. Innovation at and across Multiple Levels of Analysis, 18, 6 (2007), 989-1005.
Whitson, J. R. (2012). Thèse de doctorat intitulée : Game Design by Numbers: Instrumental Play and the Quantitative Shift in the Digital Game Industry. Ottawa, Canada: Carleton University.
Whitson, J. R. (2018). What Can We Learn From Studio Studies Ethnographies? A “Messy” Account of Game Development Materiality, Learning, and Expertise. Games and Culture, 1-23.
Veuillez envoyer votre résumé en français (entre 300 et 500 mots, excluant les références) de votre proposition d’ici le 15 février 2023 en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse suivante : https://forms.office.com/r/a6VPuAyqa0. Le résumé de votre proposition doit comprendre minimalement le titre, le sujet et la problématique abordée. Le formulaire vous demandera d’inclure également une courte bio. Vous serez informés de l’acceptation ou du refus de votre proposition par courriel en mars 2023.
En vue du texte final, le nombre de mots devra se situer entre 5000 et 7000 mots (excluant les références). Des informations plus précises en lien avec le format seront communiquées pour les textes acceptés. Suite à l’acceptation de votre proposition, vous devrez faire parvenir votre texte final avant la date de tombée fixée au 30 mai 2023 aux adresses suivantes :
erwan.davisseau@uqat.ca
dhawey@nad.ca
Vous serez prévenus ultérieurement concernant la date exacte de publication du numéro Kinéphanos.
Kinephanos est une revue Web avec arbitrage. Chaque texte reçu est soumis en anonymat à une double évaluation par les pairs. Kinephanos n’exige pas l’exclusivité de vos textes. Toutefois, l’article soumis doit être publié pour la première fois. Les textes qui paraîtront dans d’autres périodiques par la suite devront citer Kinephanos comme première source.
Pour connaître toutes les normes de présentation des manuscrits, consultez la politique éditoriale de Kinephanos.
Kinephanos est une revue Web universitaire, qui se veut bilingue, interdisciplinaire et transdisciplinaire, dont l’objectif est d’étudier les questions qui touchent de près ou de loin le cinéma et les médias populaires. Les films et téléséries populaires, les jeux vidéo, les technologies émergentes ainsi que la culture des fans constituent les principaux intérêts de la revue. Les approches favorisées sont les études cinématographiques, les théories de la communication, les sciences des religions, la philosophie et les études culturelles et médiatiques.
www.kinephanos.ca