




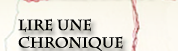

|
|
|
|
|||||
 |
 |
|
|
|
 |
||
 |
 |
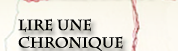 |
|||||
 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
par Robert Kemp
« Quelle est la cathédrale qui a laissé s’envoler son ange musicien ? Il a enveloppé ses ailes dans le tricot et le veston. On les devine encore quand il marche… Parce que ses pieds légers frôlent à peine la route et la rue, il a beaucoup marché. Dans sa Haute Provence natale, où il faisait des tours et des tours, parmi le thym et la rosée, oubliant le temps dans des rêves, comme Jeannot Lapin. Dans les villes.
Le bissac lui est impondérable… Seul le sac du soldat, durant la Grande Guerre, a meurtri ses épaules, où il a imprimé d’ineffaçables marques. Son frère d’Amiens lui a cédé les deux plis de son sourire… Alexandre Arnoux s’en va, à travers le monde des choses, des hommes et des idées, curieux de tout, aérien, acrobatique. Il ne s’attarde pas au même trapèze ; tout lui est trapèze, les branches de la forêt de Brocéliande, celles des sapins alpestres, penchés au-dessus du gouffre… Il ne s’attarde pas. Il a besoin de sentir la fraîcheur d’un bois nouveau, dans sa paume. Ses prouesses s’accomplissent dans la mathématique, qui sont une forme de la musique et les plus audacieuses des chimères. Naguère, il avait un émule, son aîné de peu, qui jouait comme lui à tous les jeux, qui dissimulait mieux sa mélancolie, pétillait de plus d’étincelles, qui éblouissait davantage. Mais Arnoux a autant de charmes, étale moins orgueilleusement son savoir. Jean Giraudoux est mort. Alexandre est aujourd’hui le seul représentant de cette rare famille d’esprits, à qui rien n’est étranger, des soucis ni des bonheurs, des amers ni des miels…
Dirai-je toute ma tendresse pour lui, plus profonde qu’il ne le sait ? Depuis le Cabaret, et jusqu’à cet étonnant Bilan provisoire où il est parvenu à mettre de l’ordre, comme un caissier soigneux, dans ce que nous possédons de plus que nos aïeux, et dans nos richesses perdues, l’actif et le passif, avec une aisance miraculeuse, j’ai aimé ses livres, j’ai écouté passionnément ses pièces. Je sais d’avance qu’ils seront fertiles en surprises, en enseignements, et les tremplins de bonds enivrants, par lesquels j’essayerai de le rejoindre. Ce n’est pas facile, et je reste loin en dessous. Mais la trajectoire est délicieuse.
La conversation avec lui est assez bizarre. Il monologue ; il vous oublie. Il construit de nouveaux projets en vous exposant ceux qui l’occupaient au réveil. Ses yeux, à travers les lunettes magiciennes, vous voient-ils ? Entre lui et son interlocuteur des nuées s’élèvent, mobiles, changeantes. Il jongle avec le réel et l’irréel ; il se grise à penser, et son ivresse vous gagne. Il parle de Faust ; et c’est vrai qu’il est un Faust, non par les années, non par l’ambition, non par l’ardeur sensuelle, qui doit être chez lui, mais se transpose en intellect. Des rapports, qu’il est seul à apercevoir, se nouent entre l’événement d’hier et des généralités si vastes qu’elles semblent se dilater jusqu’au paradis dont Platon a cru se souvenir, et où Arnoux, à la cime de ses songes, doit le joindre. Cette cervelle étonnante ignore le repos, les relâches. Sait-il ce qu’il mange, ce qu’il boit, ce dont il s’agit autour de la table où l’on discute d’un prix à décerner ou de la saveur d’un vin ? Des vagues de plaisir ou d’angoisse passent sur son visage… Vous rencontrer, là où il savait vous rencontrer, l’émerveille autant que si cela avait lieu au plus haut de l’Himalaya ; entre Faust et le fakir, comme dans Mon Faust de Valéry.
Si poésie est création, Alexandre Arnoux est le plus poète des hommes de ce temps. Donnez-lui un chiffre, insinuez le nom, la dernière pensée d’Einstein. Ce sorcier va en faire surgir une végétation spirituelle ; des fruits, des fleurs, des branches, que les botanistes ne connaissent pas encore. Il adore le hasard ; il préfère les lois. Mais il les veut “contingentes”, parce que la causalité rigoureuse et sans caprices l’ennuierait.
Deux arts l’ont passionné. La musique d’abord. Il serait resté, à l’exemple du moine, deux siècles agenouillé au pied du chêne où trillait un rossignol. Le “rossignol napolitain”, de préférence ; le rossignol que dans Napoli, Gustave Charpentier fit chanter à midi, ce qui n’étonne que les sots ; car la poésie et la musique ne sont pas serves de la tradition…
Un critique, s’interrogeant un jour, l’imprudent, sur la durée de l’œuvre d’Arnoux, se demandait si elle ne s’évanouirait pas en poussière impalpable mais brillante, sur les rayons des bibliothèques. Il ignorait donc la solidité du fragile ? Quand le fragile est de qualité, c’est lui qui résiste à tous les chocs. Le mélodieux roseau d’Arnoux survivra à des troncs épais. Il existe des grâces qui ne peuvent pas vieillir, ni disparaître. On lit plus les idylles de Bion que les Argonautiques d’Apollonius de Rhodes. Il faudrait, pour que s’accomplît cette prédiction abominable, que nous devinssions décidément robots, et qu’à jamais l’économique et le mécanique eussent anéanti l’onirique. Mais l’homme qui ne rêve pas est pire que l’homme qui ne rit jamais. Je crois à l’immortalité du sourire complexe d’Alexandre Arnoux.
Il a des passions. La passion des hommes exceptionnels. Le héros véritable du Rossignol napolitain est Stradella. Arnoux a été ébloui du génie précoce d’Évariste Gallois ; il a admiré sa solitude, dans une région de l’abstrait où personne, à son époque, n’était capable de le suivre ; il s’est ému de cette explosion de la pensée, chez un garçon d’origine simple, dont aucune hérédité n’explique l’originalité foudroyante. Le génie de Gallois n’était enfermé dans aucun des chromosomes paternels ni maternels. Alexandre Arnoux a choisi des amis parmi les princes de la magie : Merlin l’Enchanteur… Le nain Obéron l’a pris pour interprète. Il rajeunit les légendes, il en imagine. Sa fantaisie s’orne d’une ironie qui jamais ne blesse. Son talent est fait d’une logique particulière, qui n’est pas celle de l’absurde, mais de l’impossible ; et d’une rare générosité.
De livre en livre, il a donné tant de lui-même qu’on finirait par s’inquiéter. Sa fortune, ne l’a-t-il pas dilapidée ? Et voici, justement, ce Bilan, où l’on constate que le trésor s’est renouvelé. Jamais le procédé de l’analyse et de la dissociation n’a été utilisé avec plus d’élan ni de réussites. Chaque problème éclairci aurait fourni la matière d’un livre entier ; c’est une pépinière de romans “possibles” ; de ceux qu’il n’écrira pas, Alexandre Arnoux offre à ses cadets les sujets tout prêts. Il suggère, et donne l’exemple d’un premier débrouillage, jette en courant des aperçus qu’il n’exploite pas à fond ; mais on sent qu’il n’y prendrait nulle peine. Cela viendrait vite, et sans aide. Sa pensée est en marche. Comptez sur son information, elle est sûre ; et suivez son exemple. Rien d’humain, de social ne semble hors de son atteinte et de sa réflexion. Comment fait-il ? Dort-il ? Le rêve lui est-il un réconfort et une jouvence, le succédané du sommeil ? Saisissez ce livre-là, ou quelque autre de sa main. Vous en pourriez écrire sur des colonnes et des colonnes… Par certains côtés, ce giralducien est aussi un valéryen. On le croit voletant ; et il a une puissance extraordinaire d’attention. Si le monde extérieur ne lui apportait rien, il trouverait en lui-même de quoi penser à l’infini. Et nous faire penser, puisqu’il nous prend à témoin. Il écrit pour instruire, exciter, charmer… Il allume, il fouette vos cerveaux. Est-ce que je vais maintenant, à propos de lui, nommer Alain ? Il est temps de se taire.
Alexandre Arnoux est un homme dont on ne s’étonne pas assez, parce qu’il est vivant. Intensément vivant. Mais on s’en étonnera comme il faut — plus tard. »
(tiré de Livres de France, revue littéraire mensuelle, juillet 1955, 6e année, nº 6, p. 3-4.)